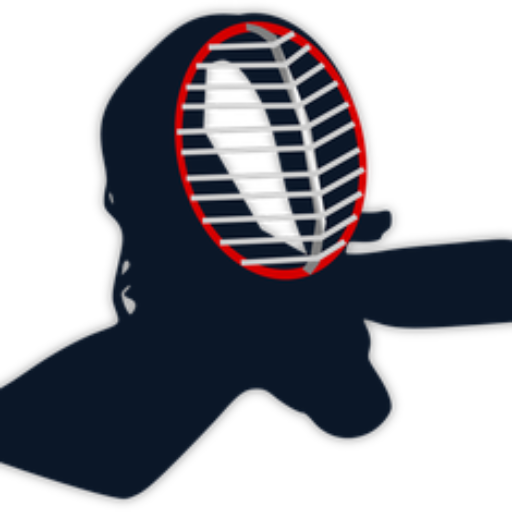La tenue de Kendo
Comment s’appelle la tenue des kendoka ? Le haut est appelé le keiko-gi (mais aussi le kendo-gi ou juste gi). C’est une veste lourde en coton tissé dont les manches couvrent les trois-quarts des bras. Le kendo-gi ressemble beaucoup au…